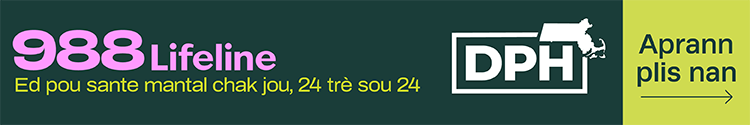Éclairage de Me João Velloso (PhD), professeur à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, dans un entretien avec Yves Cajuste pour InfoHaïti.net.
Brockton 14 septembre 2025 (dépêche) – L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de prison par la Cour suprême pour tentative de coup d’État. Une décision sans précédent dans l’histoire démocratique du pays. Jamais auparavant un ex-chef de l’État n’avait été reconnu coupable d’une telle infraction.
Le jugement, prononcé après plusieurs mois de procédures, ne se limite pas aux événements ayant suivi la défaite électorale de Bolsonaro en 2022. La Cour a retenu une série d’actions de déstabilisation entamées dès 2020, au cœur de son mandat présidentiel, comprenant des menaces contre des magistrats et même un projet d’attentat visant Luiz Inácio Lula da Silva, alors encore candidat.
Pour analyser la portée de cette condamnation, nous avons recueilli l’éclairage du professeur João Velloso, juriste à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa et spécialiste du droit criminel et comparé. Selon lui, ce verdict marque un tournant :
« Ce n’est pas seulement une réaction de Bolsonaro à sa défaite de 2022. Les atteintes aux institutions démocratiques et la préparation d’un coup d’État remontent à 2020 et 2021, alors qu’il était encore président. »
Le rôle central de la Cour suprême
La condamnation a été prononcée par la Cour suprême du Brésil, institution au mandat bien plus large que celui de ses homologues dans d’autres pays. Elle juge aussi bien des affaires constitutionnelles que des dossiers criminels majeurs. Pour Velloso, cette compétence élargie est cruciale dans un pays marqué par un lourd passé de dictatures.
« C’est une cour constitutionnelle, mais avec un mandat beaucoup plus vaste que dans d’autres juridictions. Elle veille à l’État de droit dans un pays qui a connu plusieurs transitions démocratiques et c’est pour cela qu’elle est centrale dans la vie politique brésilienne. »
Cette organisation institutionnelle, héritée de la Constitution de 1988, confère une légitimité particulière à la décision. Selon l’universitaire, elle rappelle que le rôle de la Cour n’est pas seulement juridique, mais profondément lié à la protection de la démocratie.
Au cœur du procès figurait la remise en cause du système de vote électronique par Bolsonaro. Introduit dans les années 1990, ce système est considéré comme l’un des plus sûrs au monde et constitue un pilier du processus électoral brésilien.
« Le vote électronique au Brésil est extrêmement contrôlé », insiste Velloso. « Il repose sur la biométrie, la vérification d’identité et garantit l’anonymat. Jamais il n’a été sérieusement mis en défaut. »
Bolsonaro a pourtant construit une partie de son discours politique sur l’idée que les urnes électroniques seraient manipulables. Mais, souligne Velloso, il n’a contesté les résultats que lorsqu’ils lui étaient défavorables :
« Ses alliés ont été élus avec ce même système, mais Bolsonaro ne l’a contesté qu’après sa défaite. Cela démontre une instrumentalisation politique du doute électoral. »
De la désinformation à la contre-information
Pour le professeur, qualifier la stratégie de Bolsonaro de simple « désinformation » est trop faible.
« Nous ne sommes pas dans une logique de rumeurs ou de maladresses. Bolsonaro a délibérément construit un narratif de contre-information, avec pour objectif de délégitimer les institutions démocratiques et de déstabiliser le processus électoral. »
Cette approche, selon lui, s’inscrit dans une dynamique mondiale où certains leaders populistes utilisent la défiance comme arme politique. Mais le contexte brésilien reste particulier : « Le Brésil a déjà souffert d’attaques répétées contre ses institutions. Le danger est d’autant plus grand que la société est habituée à ces tensions. »
Réactions contrastées et indépendance de la justice
La condamnation a immédiatement polarisé l’opinion. Pour une partie des Brésiliens, elle représente un pas décisif vers la consolidation de la démocratie. Pour d’autres, elle illustre une justice instrumentalisée à des fins politiques.
Le professeur Velloso nuance cette perception :
« Oui, toute décision juridique a une dimension politique, parce que le droit est produit dans un cadre politique. Mais dans ce cas précis, il ne s’agit pas d’une décision partisane. Les enquêtes ont été menées par la police fédérale et le ministère public, deux institutions indépendantes. »
Il rappelle également que la Cour a résisté à des pressions internationales :
« Quand les États-Unis ont annulé les visas de certains juges et imposé des sanctions, la Cour a affirmé son indépendance. Elle a montré qu’elle ne pliait ni devant Bolsonaro, ni devant des puissances étrangères. »
Comparaisons internationales
Des observateurs comparent souvent la stratégie de Bolsonaro à celle de Donald Trump aux États-Unis. Le professeur Velloso appelle toutefois à la prudence :
« Le Brésil possède une Constitution récente, conçue précisément pour prévenir les coups d’État militaires. Elle prévoit des sanctions claires contre les dirigeants et officiers qui portent atteinte aux institutions. Le contexte juridique est donc différent. »
Là où les États-Unis fonctionnent sur une conception très large de la liberté d’expression, le Brésil encadre plus strictement les discours qui menacent directement l’État de droit. « On ne peut pas se cacher derrière la liberté d’expression pour appeler à renverser une démocratie », résume l’universitaire.
Les conséquences militaires et institutionnelles
L’une des conséquences les plus marquantes de cette condamnation est la perte automatique du statut militaire pour Bolsonaro et ses alliés. En vertu de la Constitution de 1988, toute condamnation lourde entraîne l’exclusion des forces armées et la suppression des pensions et privilèges associés.
« Tous vont perdre leurs rangs, leurs pensions et leurs privilèges. C’est une manière explicite de couper le lien entre armée et politique, un héritage direct des années de dictature », affirme Velloso.
Cette disposition illustre la volonté du Brésil de rompre avec le passé, lorsque l’armée intervenait régulièrement dans la vie politique.
Enfin, la décision consacre une rupture avec la tradition brésilienne d’amnisties. Après chaque épisode autoritaire, le pays avait souvent choisi d’effacer les responsabilités pénales au nom de la réconciliation nationale. Cette fois, le message est radicalement différent.
« Le Brésil a longtemps pratiqué l’amnistie. Mais cette fois, le message est clair : les tentatives de coup d’État ne seront plus tolérées ni oubliées », conclut Velloso.
Pour lui, la portée dépasse les frontières nationales : « Il y a des élections : parfois on gagne, parfois on perd. Mais on respecte les résultats. La démocratie repose sur ce respect, et c’est ce que rappelle avec force ce jugement. »
Entretien avec le juriste João Velloso, professeur à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa
: